1260. Les Espagnols ayant commencé leur Reconquista, entrent dans Salé avec trente-sept navires castillans envoyés par le roi Alphonse X de Castille. Profitant de l’Aïd-el-Fitr, fêtant la fin du ramadan, ils massacrent durant quinze jours hommes, femmes, enfants, et en enlèvent plusieurs milliers pour les emmener comme esclaves à Séville. Ils pillent, violent, brûlent plusieurs quartiers. Yacoub Ben Abdelhaq, le sultan mérinide qui règne sur le Maroc à ce moment-là finit par rassembler les forces nécessaires pour chasser les Castillans.
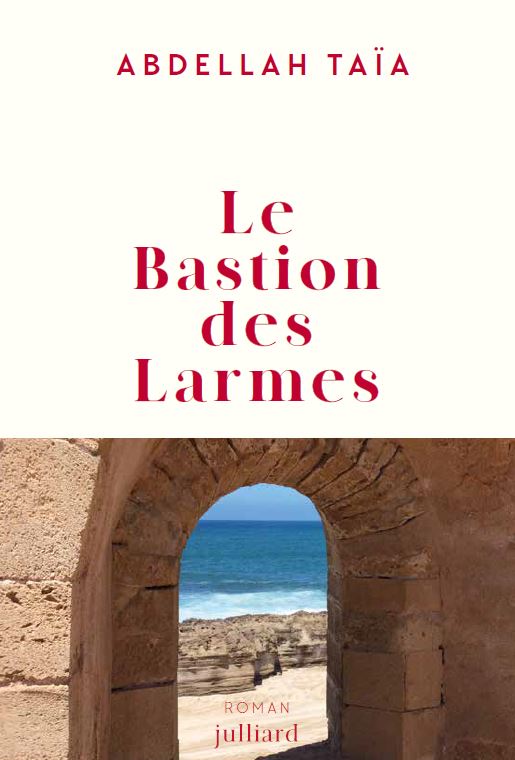
Les traces de cette bataille de Salé et de sa tragédie c’est la construction en 1261 par le sultan lui-même d’une imposante muraille (l’actuelle enceinte de Salé) bâtie sur la plage, un bastion fortifié qu’il nomma tristement Bastion des Larmes ou Bastion des Sanglots. Un lieu qui donne son titre au roman d’Abdellah Taïa, roman solaire, poignant, et puissant, où l’auteur ne fait pas qu’évoquer historiquement ce drame, donnant la parole à un certain Youssef, sorte de double de l’écrivain né à Rabat au Maroc en 1973, dont les textes en français sont traduits en plusieurs langues. Que faire du lien avec ses frères et sœurs quand les parents ont disparu ? Une vaste question abordée ici en portraits successifs peints comme des aquarelles. Passé, présent s’entrecroisent dans ce roman féministe, admirable de pudeur et d’intelligence qui bousculant la chronologie aborde l’histoire d’un homme sous l’angle politique, et libertaire, dans une prose poétique rappelant par bien des aspects l’onirisme violent de Jean Genet.
Un prof exilé en France
« Mes sœurs avaient trois jours devant elles pour payer les dettes de notre défunte mère Malika. Pas un jour de plus. Elles ont dit que c’était la tradition marocaine. Je n’ai jamais entendu parler de cette tradition mais j’étais avec elles, les sœurs, de leur côté. C’était la moindre des choses. J’ai proposé de participer moi aussi au règlement des dettes. Elles ont catégoriquement refusé. » Celui qui s’exprime ainsi dès les premières lignes du roman se prénomme Youssef. Prof exilé en France depuis vingt-cinq ans, il est revenu à Salé au Maroc, sa ville natale pour, à la demande de ses sœurs, liquider l’héritage familial.
Dès son arrivée c’est tout un passé qui ressurgit, lui sautant à la gorge et le plongeant dans ce qui est une confession sur l’intimité de son existence. En quelques pages Abdellah Taïa installe un décor, fixe les contours d’une géographie de l’intime et bouleverse le lecteur. Son nouveau roman « Le bastion des larmes » s’il demeure important dans son œuvre c’est avant tout parce qu’il opère comme une synthèse de ses précédents ouvrages. Cinéaste rompu aux gros plans sur les visages, les vues d’ensemble sur des décors foisonnant de personnages, les travellings glissant sur la plongée dans l’aspérité des choses, il évoque ici la répression de l’homosexualité dans le Maroc d’Hassan II, des années soixante-dix à quatre-vingt-dix. Il dénonce l’accaparement des richesses du pays par le roi et son ministre de l’Intérieur Driss Basri avec son lot de sévices, et par le biais de son narrateur fait résonner comme en écho les paroles de toutes les victimes de l’oppression sociale et sexuelle.
Nous suivons Youssef, autrefois enfant violé, traversant les ruelles de Salé se souvenant de tout et de tous, à commencer par la voix de Najib, son ami et amant de jeunesse au destin tragique happé par le trafic de drogue et la corruption d’un colonel de l’armée. La misère, la pédophilie, l’avenir de toute une jeunesse assombri par la peur et le martyr des corps, l’amour pur et fou également qui libère Youssef de ses chaînes, autant de thèmes développés dans ce roman contemplatif dont la structure narrative fait songer à une prière. Abdellah Taïa qui vient d’obtenir le Prix Décembre pour ce livre magnifique est d’ailleurs très ému en évoquant sa genèse et son contenu.
Jean-Rémi BARLAND
Entretien avec Abdellah Taïa : « Je voulais par ce livre rendre hommage à mes sœurs »

Destimed : « Comment avez-vous conçu ce livre ?
Abdellah Taïa : Comme un prolongement de mon univers habituellement présent dans mes autres livres. Dès le premier intitulé « Mon Maroc » je souhaitais comme ici embarquer le lecteur avec moi, et depuis longtemps je voulais parler de mes sœurs. J’en ai six. Une est décédée, et j’ai une demi-sœur. Elles avaient constitué un royaume entre elles. Elles avaient noué un lien très fort. Mon idée du monde c’était d’être avec mes sœurs, et d’apprendre la vie par leur présence, leurs paroles, leur soutien, leur accompagnement affectif. C’est cela qui m’a sauvé, moi le petit enfant homosexuel efféminé de me sentir protégé par ces six sœurs qui avaient installé entre elles une parole polyphonique extrêmement libre. L’écriture a prolongé cette idée que survivre pour moi c’était resté attaché à elles. Ce qui se passait entre elles était fascinant. Elles m’utilisaient aussi pour faire des courses, aller chercher du bois. J’étais ravi d’être « leur petit serviteur ». Elles me couvaient de leur affection, ce que j’ai vécu avec elles contredisait ce que prétendait le pouvoir marocain sur la place des femmes. Vivre avec mes sœurs courageuses et rebelles c’était installer une façon de vivre totalement folle et inspirante. Je leur rends ici hommage. Elles avaient résolu la manière de faire face au monde. Je suis devenu écrivain grâce au fait de les avoir écoutées et suivies.
Vous parlez beaucoup de vous dans ce roman, mais pour, me semble-t-il, mieux aller vers les autres ?
Vous avez raison. « Le bastion des larmes » est moins un livre sur Youssef, le double d’Abdellah que sur les autres. On le voit venir vendre la maison de famille, suivre les obsèques de Najib, cet homme qu’il a connu, qu’il a aimé, personnage pour qui j’ai beaucoup de tendresse et qui a réellement existé. Happé par le trafic de drogue et la corruption d’un colonel de l’armée de Hassan II il est une des victimes d’un système barbare. Au moment de sa mort il est revenu dans ma vie. Il m’a enseigné qu’il faut toujours se préparer à une injustice. Et ne jamais faire comme si les problèmes n’existaient pas. Et puis, il y a ce lien familial et matériel autour de la maison à vendre. J’évoque volontiers à ce sujet la bouleversante chanson « La maison » de Françoise Hardy qui dit en substance : « Ta maison est juste là à côté. Tout près d’ici ton quartier. J’arrive à ce portail décoloré, vieux de ta maison qui a vieilli, changé. Et ce jardin abandonné. Où je vois des fleurs fanées. Cela c’est tout à fait toi et cette porte toujours close bien fermée. Je ne sais plus de quoi parler. Non ta maison, elle n’est plus ici. Personne n’habite la maison qui dort. Je dis adieu à ce paysage triste. Il a ton âge, mon chagrin nouveau. Bien mort. » Je pleure en l’écoutant.
Comment avez-vous construit votre roman ?
Pour tous les livres que j’écris, je mets des années pour faire le plan. Puis j’écris dans l’ordre. Réalité et fiction se mêlent. Il y avait par exemple un autre Najib dans ma vie. Un Égyptien gay rencontré à Paris en 2006 et qui a préféré rentrer dans son pays car sa mère était en danger. J’ai vu qu’il y avait une convergence de destins entre ces deux Najib. Je m’en sers ici. Je suis par ailleurs incapable de ne pas structurer un roman. Je travaille aussi par images. Ma première rencontre avec la culture s’est passée avec la vision de films sur la télé marocaine, et la découverte du cinéma égyptien, qui s’exprimait en langue arabe, qui parlait de choses tabous, dans la même langue que nous. En passant d’une image à l’autre, moi qui suis aussi cinéaste, je travaille beaucoup sur le montage, où, le spectateur, invente des choses pour continuer l’histoire du récit qui est hors champ. Je suis très influencé par le cinéma, car enfant, les livres étaient réservés aux bourgeois, car on n’avait pas d’argent pour les acheter. Je suis extrêmement reconnaissant au cinéma égyptien et à mes sœurs de me l’avoir fait découvrir. J’y fais allusion aussi avec de l’humour comme lorsque j’évoque la figure de légende que représentait Omar Sharif, considéré par mes sœurs comme à la fois Dieu et le Roi du monde. Elles étaient dans le délire amoureux. « Omar Sharif » je l’écris était à leurs yeux « le dieu de tous les dieux. La voix de toutes les voix. l’Amour de tous les amours. Le feu et la pluie. Le rêve de tous les rêves. La beauté même. La majesté. La raison pour laquelle cet univers a été créé. » Du haut de mes neuf ans, moi qui n’avais aucune idée de qui était Omar Sharif j’avais du mal à les suivre, mais je les écoutais, fasciné.
En quoi ce cinéma a-t-il influencé l’écriture de vos films et de vos romans ?
Les films égyptiens ne passaient à la télévision que le vendredi. En les attendant d’une semaine sur l’autre, je repassais dans ma tête la bobine précédente. Je réécrivais le film que je venais de voir, Mon cerveau a alors compris que se créait une certaine solidarité de pensée entre eux et moi. Je savais qu’il faudrait que je mette tout ça dans mes films et mes livres. C’est aussi cette décision qui a fait de moi un écrivain et un réalisateur.
Outre son titre « Le bastion des larmes » -qui pourrait s’appeler – « Les larmes de l’exil » fait référence à un fait historique que nous avons évoqué, et il y a dans le roman l’évocation de l’idée d’exil et de la différence…
Oui, bien sûr et notamment avec le personnage de Kaddour qui symbolise le rejet du droit à la différence d’un LGBT victime de violences. Je voulais revenir sur ce personnage gay dans le quartier qui l’a nié, et qui fut forcé à s’exiler. L’exil on ne l’accepte pas, parce que c’est inacceptable ! Je ne vois pas pourquoi on doit vivre cet exil permanent de son pays et de soi. Ce roman le dénonce en tout cas.
Est-ce que l’enfant Abdellah est fier de ce qu’est devenu l’adulte Taïa ?
Sans doute satisfait en tout cas, car j’ai du mal avec ce mot « fier » qui est associé à mes yeux au patriotisme. Ce patriotisme qui niait l’homosexuel que j’étais et la liberté prônée par mes sœurs. On nous disait sans cesse « soyez fiers d’être Marocains ». Si je veux m’attribuer un sentiment de fierté c’est celui de voir ce que, par l’écriture, je réinvente constamment de moi et du monde. Ce mot « fier » n’est pas la fin d’un combat mais son début.
Propos recuellis par Jean-Rémi BARLAND
« Le bastion des larmes » par Abdellah Taïa – Julliard – 215 pages – 21 €



