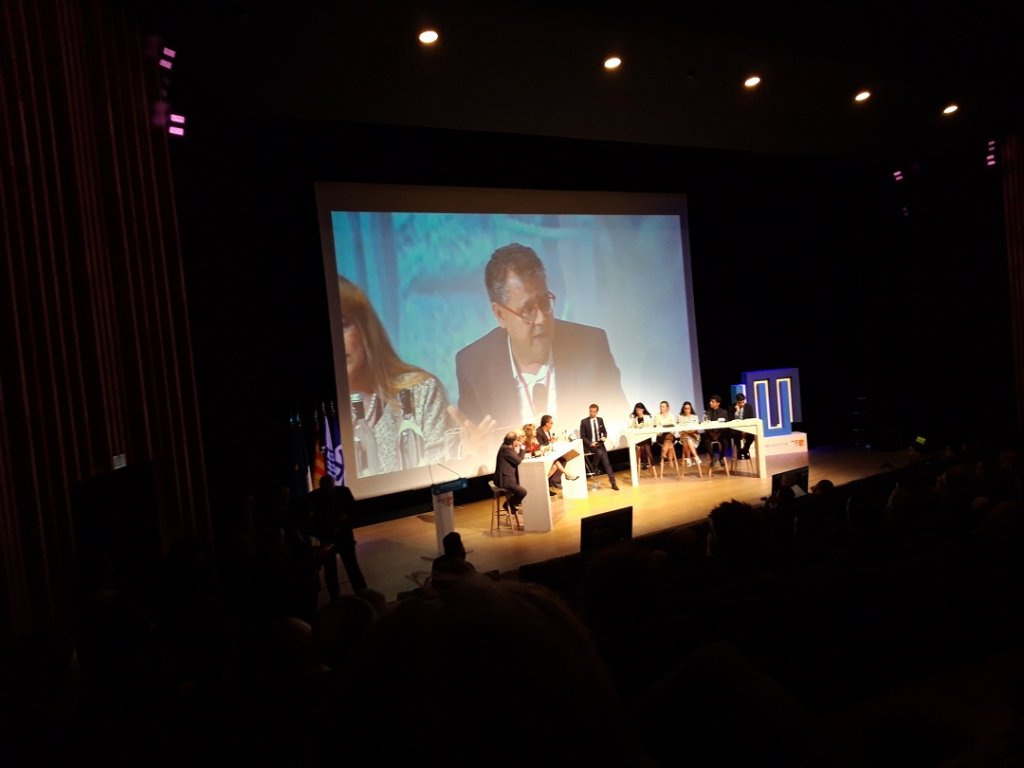Publié le 23 novembre 2018 à 16h44 - Dernière mise à jour le 29 octobre 2022 à 13h46
Ils sont doctorants, entrepreneurs ou écrivains, ils s’illustrent dans le numérique, l’archéologie, l’éco-construction ou les concours d’éloquence et ils viennent d’Algérie, de Roumanie, du Maroc, de France ou de Tunisie : la jeunesse méditerranéenne a pu interpeller les décideurs le 13 novembre dernier, à l’occasion de l’Acte II de la Méditerranée du futur.

Construire l’écosystème propice à la créativité de la jeunesse
Même positionnement chez Youness Ouazri (Maroc), fondateur d’Ecodome, entreprise de construction écologique, dans le domaine de l’urbanisme. «La jeunesse représente un potentiel et une chance pour chaque territoire. Pour la faire avancer, il faut lui donner les bons outils pour construire les villes méditerranéennes de demain. Or il faut savoir que la gouvernance de la construction de la ville évolue, les modèles en silo où tout est segmenté marchent de moins en moins, au profit de la transversalité. Il faut donc mettre en place une gouvernance qui implique la participation des citoyens, dont les jeunes». Des logiques collaboratives auxquels les process administratifs, les organisations gouvernementales d’aujourd’hui ne sont pas forcément toujours adaptés… Mais ces dernières y travaillent, comme l’exprime Nooman Fehri, ancien ministre tunisien des technologies de l’information et des communications. «Les jeunes ont des attentes internationales, ils le vérifient avec Internet, où ils sont tous connectés. Mais sur leur lieu de vie, tous ne bénéficient pas des mêmes moyens. D’où un gap. Or nous savons que vous avez la flexibilité et l’esprit pour changer les choses… De notre côté, nous allons dans le sens d’une Tunisie 2.0. Quatre piliers ont été identifiés : faire que toutes les maisons aient le haut débit d’ici 2022, aller vers l’éducation digitale, tendre vers l’administration sans papier et enfin, transformer les lois, notamment sur les start-up et l’innovation. Si on met en place ces quatre piliers, vous les jeunes, vous allez vous en servir. Notre rôle est de construire l’écosystème qui vous permettra de faire ce que vous avez envie de faire, même si on ne sait pas ce que c’est». Bref, un passage de témoin, dans la course de relais vers la fondation de la Méditerranée de demain.Débusquer les points de blocage
Mais d’autres pays ont une longueur d’avance en la matière. Ainsi Israël, en sa qualité de «Nation Start-up», a beaucoup à transmettre en matière d’accompagnement de l’innovation, explique Anita Mazor, ministre en charge des Régions Paca, Occitanie, Aquitaine et Corse auprès de l’ambassade d’Israël à Paris. Ce petit pays, qui voit très grand par nécessité en termes d’export, a su développer ses écosystèmes pour gagner en compétitivité. «Beaucoup viennent chez nous pour apprendre comment on fait. Nous avons instauré un concours pour inciter les start-up à venir en Israël en collaboration avec la French Tech Aix-Marseille et Thecamp. Amélie Starace, la dirigeante de Playzz, en était cette année la gagnante, elle va venir une semaine à Haïfa en immersion». Outre leurs suggestions, la jeunesse de la Méditerranée ne se prive pas non plus d’être critique. C’est ainsi que les participants à l’échange ont pointé du doigt certaines lacunes, face auxquelles leurs aînés n’ont pas forcément encore de solutions à portée de main. Ainsi Alexandra Bilovaru trouve-t-elle «difficile ici de déboucher sur un travail de jeune chercheur dans le monde académique. Nous sommes souvent obligés de nous diriger vers le milieu privé… A contrario en Algérie, la plupart des doctorants parvient à travailler dans ce même milieu académique, et à obtenir un statut d’enseignant». Le jeune écrivain Anis Mezzaour évoquera quant à lui le «problème de l’attractivité des territoires : des flux d’étudiants de la rive Sud viennent intégrer les universités de la rive Nord, mais jamais l’inverse. Quels partenariats de qualité pourrait-on mettre en œuvre pour développer l’enseignement sur la rive Sud ? » Amélie Starace en viendra aux travers des incubateurs développés au sein des grands groupes. «Ils font de la sélection en fonction du business model, de la capacité de croissance. Or les citoyens qui créent des réponses aux problèmes d’ordre environnementaux, qui s’illustrent dans des domaines tels que l’éducation n’ont pas vocation à faire de gros chiffres d’affaires. Alors, comment s’assurer d’être accompagné malgré tout ? » A défaut de pouvoir remédier dès aujourd’hui à ces manques, les décideurs acquiescent. Première condition sine qua non pour mettre en œuvre des solutions. «Je suis d’accord avec vous : les critères de responsabilité sociale et environnementale, le potentiel de création d’emploi devraient être pris en compte au même titre que l’évolution du chiffre d’affaires », abondera Blanca Moreno Dodson, Directrice du Centre pour l’intégration en Méditerranée (CIM).Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage pour la jeunesse

Vers le Sommet des deux Rives, en juin prochain
Mais cet Acte II de la Méditerranée au futur dédié à la jeunesse n’est finalement qu’une étape de construction. Car elle appelle d’autres initiatives. Le prochain rendez-vous phare, ce sera donc le Sommet des deux rives, organisé à Marseille le 24 juin 2019. Et Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, en a dévoilé un peu plus dans les conclusions sur l’événement, «qui se tiendra au Palais du Pharo», a-t-il annoncé. Dans les faits, «ce ne sera pas un sommet au sens classique du terme. Ce sera la même formule que pour la Méditerranée au futur, puisque nos dirigeants seront amenés à rencontrer des personnalités qualifiées issues de la société civile, des forces vives de la Méditerranée». Le but de ces échanges, bien sûr : mettre en avant ce qui unit les participants des divers pays et dessiner une vision partagée de la Méditerranée. «Montrer que les pays du Nord ont à apprendre de ceux du Sud, et vice versa». Mais aussi et surtout, impulser des actions concrètes à la faveur «de programmes d’investissements nouveaux». Tout cela se discutera autour de cinq thèmes, déjà définis : l’économie et la compétitivité, l’environnement, l’énergie et les matières premières, la jeunesse et l’éducation et enfin, la culture. Et Jean-Yves Le Drian n’a pas manqué de donner quelques pistes d’actions bilatérales : «La création d’une école méditerranéenne des métiers de la mer, d’un réseau méditerranéen des écoles de la deuxième chance, des actions en faveur de la réduction des émissions polluantes ou du zéro plastique en Méditerranée, la mise en place d’un label méditerranéen du développement durable… ». Des idées nouvelles pour ré-identifier ce large périmètre et «retrouver une politique méditerranéenne refondée». Carole PAYRAU A lire aussi Méditerranée du futur Acte II : Préparer l’avenir en créant en commun (1/2)Acte II de la Méditerranée du futur: Les entretiens de Mireille BIANCIOTTO