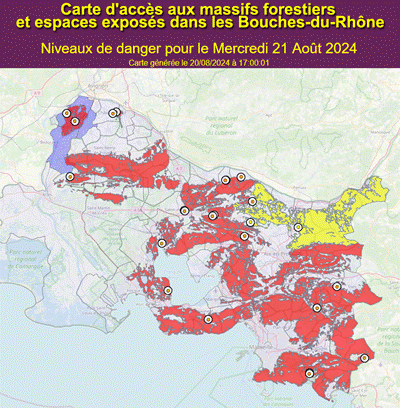Publié le 9 septembre 2019 à 10h04 - Dernière mise à jour le 29 octobre 2022 à 12h30
L’événement attendu, se tiendra en juin prochain à Marseille, au parc Chanot. Mais afin qu’il garde toute sa capacité d’influence, un congrès mondial de l’Union Internationale pour la conservation de la nature (UICN) se prépare en amont. C’était l’objet de la journée de débats du 12 juin dernier, organisée à Marseille.