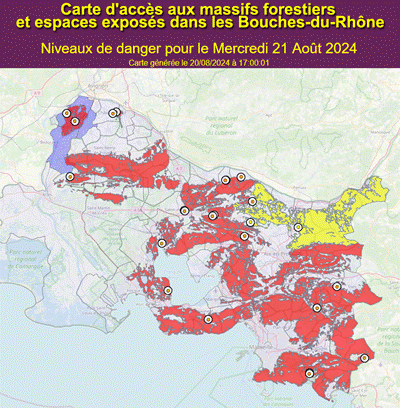Publié le 12 septembre 2013 à 15h28 - Dernière mise à jour le 27 octobre 2022 à 16h18
Nos hommes (et femmes) politiques sont-ils suffisamment formés en France aux questions liées au fonctionnement de l’entreprise et de l’économie de marché ? A priori non si l’on en croit les intervenants du débat sur le thème « Les hommes politiques aiment-ils l’entreprise ? », parmi lesquels les anciens ministres Xavier Bertrand et Renaud Muselier, dans ce qui a constitué un des temps forts de la 13e édition du Forum des Entrepreneurs, le rendez-vous de la rentrée de l’UPE 13.

« Les hommes politiques aiment-ils l’entreprise ? » : c’était le thème d’une des tables rondes les plus attendues du 13e Forum des Entrepreneurs qui s’est tenu sur le thème « Entreprises et pouvoirs », ce vendredi 6 septembre à la Kedge Business School de Marseille à Luminy. Pour en débattre, l’Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône (UPE 13) avait réuni cinq invités prestigieux : l’ancien ministre de la Santé et du Travail Xavier Bertrand (UMP), qui a été agent général d’assurances de 1992 à 2004 en parallèle à ses activités politiques ; Renaud Muselier (UMP), ancien secrétaire d’Etat à la Défense de 2002 à 2005 et Premier adjoint au maire de Marseille de 1995 à 2008, qui a pris du recul avec le monde politique et a repris son activité professionnelle de directeur de clinique privée depuis sa défaite aux élections législatives de 2012 ; Daniel Cohen, désigné « Economiste de l’année » en 1997 par Le Nouvel Economiste, qui avait lors de la dernière élection présidentielle signé l’appel des économistes en soutien du candidat François Hollande ; Jean-Marc Forneri, ancien conseiller auprès d’Edouard Balladur au ministère de l’Economie et des Finances, créateur de la société indépendante Bucéphale Finance, spécialisée dans le conseil financier, devenue l’un des leaders de fusions-acquisitions sur la place de Paris, un économiste qui jouit de l’écoute d’un certain Nicolas Sarkozy ; et Nathalie Loiseau, directrice de l’Ecole Nationale de l’Administration (ENA), la première directrice à avoir été nommée à la tête de l’institution suite à un appel à candidatures. Quant à Pierre Grand-Dufay, président de Tertium et vice-président de l’UPE 13, il avait pour l’occasion endossé les habits Monsieur Loyal.
Pour Jean-Marc Forneri, savoir si les hommes politiques aiment l’entreprise est assurément une « vaste question ». « Qui n’aime pas l’entreprise dans ce pays, ne serait-ce que par les mots, que ce soit chez les hommes politiques ou les journalistes ? Mais à la question “est-ce que les hommes politiques s’intéressent à l’entreprise ?”, la réponse est non car l’entreprise n’est pas un enjeu », tranche l’économiste. Et d’expliquer : « Sous la pression du monde médiatique, on se situe en politique dans un rapport de forces. Les agriculteurs sont capables de déverser des marchandises dans les rues, les syndicalistes sont en mesure de bloquer le pays, les opposants au “mariage pour tous” peuvent réunir un million de personnes dans les rues. Mais comme Staline disait “le Vatican, combien de divisions”, les entreprises, combien de divisions ? »
Jean-Marc Forneri évoque aussi la représentation parlementaire. « Au Parlement, seuls 7% des élus sont des chefs d’entreprises et il n’y a aucun ouvrier, nous sommes le seul pays dans ce cas. Nous sommes en train d’élire de gens qui ne connaissent pas l’entreprise. Et dans l’ensemble, les ministres ne viennent pas du monde de l’entreprise. Nous avons même une ministre du Commerce extérieur (NDLR : Nicole Bricq) qui ne parle pas anglais », ironise-t-il, avant de préciser que « c’est vrai pour la gauche comme pour la droite ». « Sur les dix dernières années, tous les ministre des Finances, à l’exception de Thierry Breton, appartenaient à la sphère publique. Pierre Bérégovoy, issu de Gaz de France, est celui qui a fait les plus grandes réformes », considère-t-il.
« Il faudrait qu’un fonctionnaire ne puisse pas rester dans la Fonction publique s’il est élu »
Mais cette non-représentation des entrepreneurs au Parlement et au gouvernement n’est pas le seul écueil rencontré par la France aux yeux de l’économiste. « Est-ce que les entrepreneurs s’intéressent à la politique ? », s’interroge ainsi Jean-Marc Forneri, avant d’enchaîner : « C’est facile de dire qu’il s’agit d’un monde peuplé d’énarques. Mais il faut entrer en politique. Si on a envie d’avancer, il faut aller à la rencontre des hommes politiques. Les agriculteurs l’ont compris : ils ont des élus puissants. Aujourd’hui, le seul patron élu est Serge Dassault au Sénat. Nous ne pouvons pas critiquer le monde politique sans essayer d’y entrer et d’en devenir des acteurs. »
Or, le créateur de Bucéphale Finance estime qu’une réforme est nécessaire pour mettre fin à la surreprésentation des hauts fonctionnaires dans la sphère politique. « En Grande-Bretagne, si vous vous présentez à une élection, élu ou pas, vous devez démissionner de la Fonction publique. En France, il y a un va et vient entre la politique et la Fonction publique alors que le patron prend un risque. Il faudrait qu’un fonctionnaire ne puisse pas rester dans la Fonction publique s’il est élu », tranche l’économiste.
Jean-Marc Forneri pointe aussi le cumul des mandats, « une catastrophe » qui « a transformé la politique en métier ». « Un homme politique peut dire n’importe quoi, c’est son plat de lentilles, image-t-il. Qui peut me dire le métier de M. Juppé, de M. Ayrault ? Qui a exercé un métier au cours des dix dernières années ? », observe-t-il, avant d’asséner : « C’est très grave quand la classe politique est déconnectée de 60 à 70% de la vie réelle. C’est une césure démocratique grave. »
L’ancien conseiller d’Edouard Balladur estime ainsi que « si les entreprises ne vont pas vers le monde politique, le monde politique ne viendra pas vers nous ». Et à ses yeux, il y a urgence. « En 10 ans, aucune réforme structurelle n’a été entreprise en France. On est sur la minimisation des mécontentements avec comme dernier exemple en date la “non-réforme” des retraites. La France perd ses jeunes entrepreneurs qui, à 20-30 ans, vont lancer des entreprises à Palo Alto ou en Grande-Bretagne. Nous avons besoin de “Clémenceaux” et nous avons aujourd’hui des “Daladiers” », conclut Jean-Marc Forneri.
Un constat que tempère Daniel Cohen qui observe que lorsqu’« on a essayé de faire venir des gens de la société civile au gouvernement, cela a presque toujours été un échec », comme en attestent à ses yeux les exemples de Francis Mer et Claude Allègre. « Il est difficile de prendre quelqu’un de la société civile et d’aller à la tribune de l’Assemblée nationale. Je ne sais pas si c’est un métier, mais ce qui est sûr, c’est que ça ne s’improvise pas », observe-t-il. Quant au fait que la politique soit devenue un métier, il juge que « ce n’est pas le cas qu’en France ». « Quel est le métier de Barack Obama, de John Kerry ? Ils ne sont que des hommes politiques », relève-t-il.
« La France est l’héritière d’un capitalisme d’Etat. C’est ce modèle qui est en crise »
Cela n’empêche cependant pas l’économiste de souligner qu’il existe « des singularités » dans l’Hexagone. « La France est l’héritière d’un capitalisme d’Etat. Les patrons du CAC 40 sont issus de la méritocratie française. On monte les échelons de l’administration et on devient directeur du Trésor. Et c’est là qu’on découvre l’entreprise en en devenant directeur. C’est ce modèle de capitalisme d’Etat qui est en crise », considère Daniel Cohen, avant d’ajouter : « La France n’est pas capable d’avoir un modèle à l’américaine comme la Silicon Valley ou de grandes entreprises innovantes comme en Allemagne. C’est ça qui est en crise et du coup on retrouve la crise de la sociologie française. »
L’économiste pointe ainsi le paradoxe qui entoure la recherche et développement (R&D) dans l’Hexagone. « La France est le pays où le taux de subvention de la R&D est le plus élevé du monde : 34% de l’innovation est financée par l’Etat, contre 7% aux Etats-Unis et 10% au Japon. Et pourtant, la recherche décroche en France. C’est parce que les entreprises font moins de R&D que leurs concurrents. Le problème c’est que nos grands groupes font de la R&D dans leur secteur et ne sont pas capables d’identifier d’autres secteurs de la recherche », analyse-t-il.
Ainsi à ses yeux, c’est un « problème plus général que celui des hommes politiques ». Selon lui, la question est ainsi de savoir « comment le système de méritocratie peut évoluer pour entrer dans un système d’innovation ? ».
Daniel Cohen estime également qu’à l’heure où 70% d’une classe d’âge accède au Bac, « le monde universitaire n’est pas adapté à ça ». « Le Français à 6 ans a soit dans l’idée qu’il sera dans l’élite, un polytechnicien par exemple, soit qu’il sera délaissé, qu’il aura raté sa vie : on n’a pas l’image d’une réussite du premier au dernier sans grande rupture. C’est bien entendu faux, mais c’est l’idée qu’on en a », insiste-t-il.
Il observe enfin que « le monde politique est trop représentatif de l’Etat » et que « dans n’importe quelle entreprise, on a une surreprésentation de l’ENA et des hauts fonctionnaires ». « C’est le problème français, lié à la tradition française », conclut-il.
Xavier Bertrand relève quant à lui qu’« il n’y a aucune raison que les hommes politiques n’aiment pas l’entreprise ». « Mais plus que ça, la question est la suivante : est-ce qu’ils connaissent et comprennent l’entreprise ? », rectifie-t-il. Or, aux yeux du député-maire de Saint-Quentin, « ils la connaissent très peu et très mal ». L’ancien ministre met notamment en cause la conception de leur rôle qu’ont les hommes politiques en France. « Il est omniprésent, il fait tout, il sait tout. Il dit qu’il crée des emplois, mais un homme politique ne crée des emplois que dans sa mairie ou son conseil général. Son job est de créer les conditions pour que l’entreprise crée des emplois », résume-t-il.
« Si j’avais arrêté la politique, j’aurais dû me chercher un autre métier »
L’ancien agent général d’assurances souligne aussi que la réinsertion professionnelle dans le privé est loin d’être aisée pour un élu de la République. « Aujourd’hui, si j’avais arrêté la politique, j’aurais dû me chercher un autre métier. Mon cabinet d’assurances, dont j’ai revendu mes parts en 2004, ne m’attendait pas », explique-t-il. Pour autant, il juge que les entrepreneurs ont beaucoup à apporter à la réflexion politique. « Dans nombre de communes, les gens qui viennent du monde de l’entreprise, on est content de les avoir. La politique est un monde qui s’appréhende marche après marche. Le fait de découvrir une arène locale permet d’apprendre un certain nombre de codes. Il ne faut pas les jeter dans l’arène de l’Assemblée nationale et les voir se planter », souligne l’ancien ministre.
Xavier Bertrand relève également qu’aux Etats-Unis les passerelles entre public et privé sont beaucoup plus nombreuses. « Mais il n’y a pas le même regard sur l’argent. Il n’y a pas de publication du patrimoine des élus », observe-t-il. Et d’en arriver à ce constat : « Les hommes politiques ne comprennent pas bien le monde de l’entreprise, et les entrepreneurs, compte tenu de leur situation, n’ont pas cherché à pénétrer le monde politique ».
Pour le maire de Saint-Quentin, la place de l’ENA est aussi « un véritable sujet ». « Les élites passent par-là : ils ne connaissent pas le monde de l’entreprise, ou en tout cas pas assez », avance-t-il. Un travers qui, selon lui, ne se corrige pas par la suite une fois qu’ils sont entrés en politique. « Si vous connaissez le CAC 40, vous ne connaissez pas l’entreprise. Or, quand vous êtes responsable politique, qui pousse votre porte ? Les patrons du CAC 40. Qui vous accompagne en voyages officiels et internationaux ? Les patrons du CAC 40. Mais ils ne sont pas représentatifs du monde de l’entreprise : ils évoluent dans des entreprises quasi institutionnalisées », souligne-t-il.
Enfin, Xavier Bertrand considère que « la classe politique est traumatisée par la perspective de reprendre les idées du monde de l’entreprise, d’être perçue comme l’amie des patrons », un état d’esprit en partie imputable selon lui au monde médiatique. Si bien qu’au final, « les hommes politiques n’ont pas compris leur rôle ». « Il faut qu’ils se transforment et que le monde de l’entreprise se transforme. Le mouvement des entrepreneurs ne s’est jamais transformé en parti des patrons, il n’a jamais eu ce rôle de lobby. Dans d’autres pays, ça a été un succès, en France, c’est un manque », considère-t-il.
A la fois chef d’entreprise et homme politique, Renaud Muselier dresse un constat sans appel entre ces deux personnages qui « ne pensent pas pareil, n’ont pas les mêmes préoccupations et pas la même formation ». « Le chef d’entreprise prend des risques avec des règlements faits par les hommes politiques. Il est au pilotage d’un être vivant qui doit s’adapter aux écueils du marché, il doit payer chaque mois des salaires et l’Urssaf, et il s’est formé à ce monde compliqué », résume-t-il, d’une part.
« L’homme politique n’a pas un parcours qui passe par les livres »
De l’autre côté du miroir, l’homme politique a quant à lui « trois voies d’accès » au monde qui est le sien : « militantisme, parachutage ou transfusion lorsque des quotas sont instaurés pour être représentant de la société civile ». « L’homme politique n’a pas un parcours qui passe par les livres. Je suis arrivé au Quai d’Orsay sans avoir été particulièrement formé à la diplomatie française. Pourtant à Washington, je n’ai pas dit une bêtise pour le pays alors que Chirac voulait que je sois ministre des Sports », se souvient le premier vice-président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (MPM). Ainsi à ses yeux, la formation de l’homme politique « passe par des réunions, des concertations, ce qui ne s’apprend pas dans nos entreprises ». « Il a besoin de s’imposer dans sa famille politique, de gagner des élections pour progresser ou de faire perdre son voisin pour ne pas régresser », souligne Renaud Muselier.
L’ancien ministre rappelle également que « la volonté d’un homme politique est de se faire réélire ». « L’homme politique présente un programme qui lui permet de gagner. Après le grand homme politique prend des décisions pour se faire réélire. Il peut aussi prendre des décisions pour l’intérêt général sans se faire réélire, ou encore avoir la malice de se faire toujours réélire en oubliant l’intérêt général », observe-t-il.
Et d’insister sur le fait qu’en politique, « ça n’existe pas l’aller-retour ». « C’est un vrai métier. On se fait cracher dessus, il faut l’assumer. C’est un travail jour et nuit. Il faut 15 ans de vie pour être député. C’est une passion phénoménale. Un chef d’entreprise prend les week-ends ; nous, on ne les prend pas les week-ends », assène l’ancien Premier adjoint au maire de Marseille. Et comme il n’est pas possible de revenir en arrière, « on s’accroche à notre siège, puis on s’assoit dessus et on tire sur tout ce qui bouge ».
Or, si « les hommes politiques ne créent pas d’emplois mais les conditions pour créer des emplois », Renaud Muselier relève cependant que « par engagement vous êtes présent et vous êtes influent ». Car l’ancien ministre rappelle que pour entrer en politique « il faut intégrer des structures partisanes car ce sont elles qui pèsent ». « Il faut dire que je suis de droite ou de gauche. Et ça, c’est difficile pour un chef d’entreprise de 200-300 personnes qui ne sont pas toutes de droite ou de gauche », fait-il remarquer. Ce qui explique à ses yeux pourquoi les rares ministres venant du privé sont plus souvent avocats qu’issus du monde de l’entreprise.
Le premier vice-président de MPM estime encore que « l’homme politique doit être représentatif de la population ». « Et aujourd’hui, la classe politique est issu du public car rien n’est fait pour les gens du privé. Il est en effet impossible d’être homme politique et chef d’entreprise car cela générerait des difficultés pour l’entreprise », analyse-t-il. Ainsi selon lui, « c’est la classe politique qui doit s’autogérer pour promouvoir des gens différents. Et il y a nécessité pour le chef d’entreprise de s’y investir. »
« Ce sont des fantasmes de croire qu’on les attend avec le tapis rouge et il n’y a pas de parachutes dorés »
Nathalie Loiseau tient pour sa part à tordre le cou à certaines idées reçues en apportant son « regard de praticien ». « Quand on dit que les fonctionnaires peuvent faire un aller-retour entre le monde politique et la Fonction publique, ce n’est pas forcément le cas. Dominique de Villepin (NDLR : ancien Premier ministre), Bruno Le Maire (NDLR : ancien ministre de l’Agriculture) ont remis leur démission, alors que Brigitte Girardin (NDLR : ancienne ministre de l’Outre-Mer) est allée dans le privé. La question qui se pose est comment les gérer ? Ils n’ont plus de parcours dans la Fonction publique car ils ont eu une carrière politique », plaide-t-elle.
Une explication qui est loin de convaincre Xavier Bertrand. « Ces trois-là, c’est vraiment leur choix : ils ont trouvé mieux. Par exemple pour Dominique de Villepin, il n’y a pas photo entre avocat d’affaires et un poste d’ambassadeur. Mais c’est différent d’avoir un parachute d’ambassadeur que le chômage », rétorque l’ancien ministre du Travail. Pour autant, Nathalie Loiseau persiste et signe. « Oui, ils ont un salaire mais il est très loin de ce qu’ils ont eu avant. Et il y a une prise de risque. Ce sont des fantasmes de croire qu’on les attend avec le tapis rouge et il n’y a pas de parachutes dorés », assène-t-elle.
Elle tient également à rappeler que « seuls 1% des énarques ont eu une carrière politique ». « D’autres sont en entreprise comme Jean-Marc Forneri », fait-elle observer. Enfin, la directrice insiste sur le fait que l’ENA est « un système de méritocratie ». « Les personnes ne sont pas là parce que leur père y était. Et quand ils réussissent, vous en faîtes des références. On a tendance dans ce pays à jeter l’anathème quand on a une difficulté. Fonctionnaire, c’est un gros mot, ou patron c’est un gros mot. J’aimerais que ni l’un, ni l’autre ne le soit », poursuit-elle. Ainsi, en ce qui concerne « le décrochage de la France », Nathalie Loiseau estime que la question n’est pas « est-ce que les hommes politiques aiment l’entreprise, est-ce que c’est la faute des fonctionnaires, des patrons ? », mais « comment faire pour travailler ensemble afin que les gens aiment davantage l’entreprise ? ». « Je ne suis pas sûre que l’élite a eu une bonne compréhension de l’entreprise. Il faut casser les barrières », estime-t-elle.
C’est en ce sens que tous les élèves de l’ENA font un stage en entreprise. Mais « le vrai sujet » à ses yeux est « quels stages ? ». « Il n’y a rien qui ressemble plus à une administration qu’une grande entreprise dans son siège parisien. Donc il faudrait que quand ils vont en entreprise, ils la découvrent dans des entreprises de taille intermédiaire (ETI), des entreprises de petite taille, pas forcément en région parisienne mais à travers la France. Et qu’ils voient leurs besoins, leurs attentes », plaide la directrice.
« La France est droguée à la dépense publique »
Elle considère encore que « les grands moments d’innovation en France sont les moments où on a marché ensemble ». « Pour les entreprises étrangères, quand le public et le privé travaillent ensemble, c’est l’une des raisons du choix de la France. Or, je ne suis pas certaine qu’ils savent toujours travailler ensemble. Il faut casser cette tendance française à la division », martèle-t-elle. Elle pointe aussi la méconnaissance de l’économie dans l’Hexagone. « Est-ce qu’on enseigne bien l’économie en France ? A l’ENA, je suis prête à m’y atteler, mais avant il y a l’école, le lycée », observe-t-elle.
Et de conclure en soulevant un ultime écueil. « En France, on est sur des trajectoires très cloisonnées. On a cette culture du diplôme qui vous suit toute votre vie. Quand une personne a plus de 50 ans et qu’elle vous parle encore de sa promotion, j’ai envie de l’envoyer chez un psychiatre », ironise-t-elle.
Jean-Marc Forneri souligne que la France n’est pas une exception et qu’en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis, les grandes entreprises sont également dirigées par des diplômés des universités les plus prestigieuses, Oxford ou Cambridge outre-Manche, Stanford ou Harvard outre-Atlantique. Il considère toutefois que « le modèle où les diplômés de l’ENA dirigeaient de grandes entreprises est en train d’évoluer », avec notamment des hommes comme Bernard Arnault, François Pinault et Xavier Niel. Un constat qui n’empêche l’économiste de pointer une spécificité française : « le principe de précaution ». « C’est le seul pays qui dit qu’il ne faut pas prendre de risques et on l’a constitutionnalisé. Roselyne Bachelot a ainsi dépensé 500 M€ pour rien et n’a pas été sanctionnée », dénonce-t-il. « Elle n’a plus été ministre », tempère Xavier Bertrand. « C’est le moins », rétorque Jean-Marc Forneri.
Nathalie Loiseau s’interroge pour sa part sur « qui rentre dans les grandes écoles ? ». « Est-ce qu’on est capable d’attirer une diversité de talents ? C’est une question où la France n’est pas en avance », estime-t-elle avant de s’appuyer sur la composition de l’assistance : « Combien de femmes, combien de chefs d’entreprise de moins de 50 ans ? Il n’y a qu’à regarder l’hémicycle : on a un vrai problème de parcours, de diversité, de talents. »
Pour la directrice de l’ENA, « il faut qu’on se donne la peine d’ouvrir nos sociétés aux jeunes ». « Si vous n’êtes pas complétement formaté au modèle français, votre chance d’arriver dans une grande école est minime. N’importe où ailleurs, on est capable d’attirer des talents plus tiers », tranche-t-elle.
Enfin, alors que l’on se demande si les hommes politiques aiment l’entreprise, Nathalie Loiseau se demande pour sa part « si la France aime l’entreprise ». « Mais ce qui est sûr, c’est que la France aime la dépense publique, elle est droguée à la dépense publique. Dès qu’il y a un problème, la première question qui se pose est : “Que fait l’Etat ? Quelles mesures va-t-il prendre ?” C’est un problème dont on est seulement en train de sortir », juge-t-elle. Un état d’esprit qui explique en grande partie à ses yeux les difficultés que rencontrent les hommes politiques pour entreprendre des réformes structurelles dans l’Hexagone. « Que ce soit pour la protection sociale ou les retraites, c’est difficile car il y a une attente de protection sociale phénoménale », observe-t-elle avant d’enfoncer le clou : « Les hommes politiques savent compter leurs électeurs pour se faire réélire. Il est donc difficile d’aller à l’encontre de ce qui est une demande forte. »
« Les hommes politiques sont élus sur un programme et ils appliquent les décisions par rapport à leur programme et leur idéologie »
Pour Jean-Marc Forneri, il s’agit là d’un vrai problème de « courage » politique. Et de dénoncer le dérapage des dépenses publiques. « Le déficit de l’Etat est abyssal car il est de plus en plus mal géré. Les collectivités publiques, Hôtels de Région, de Département, mairie et services culturels, empilent les dépenses. Le secteur mutualiste, 642 Mds€ d’actifs, est géré de manière absurde. Il suffirait pourtant de seulement 1% d’économies pour dégager 6,5 Mds€, soit la somme actuellement recherchée par le gouvernement », pointe-t-il. Un constat dans lequel l’économiste n’épargne pas les chefs d’entreprise. « Les 37 Mds€ de la formation professionnelle, nous les gérons aussi, donc nous sommes aussi responsables de cette mauvaise gestion », fait-il remarquer. Il aimerait ainsi que les hommes politiques s’inspirent de n’importe quelle ménagère qui « dépense moins quand elle a un problème ».
Jean-Marc Forneri estime enfin que « le système éducatif est dans une situation d’échec absolu ». « Les ouvrages d’économie et de sciences sociales sont une honte absolue. L’entreprise est décrite comme exploitant », relève-t-il.
Renaud Muselier insiste pour sa part sur le fait qu’avec les hommes politiques, « il n’y a pas de surprise ». « Ils sont élus sur un programme et ils appliquent les décisions par rapport à leur programme et leur idéologie », résume-t-il. Et de dresser un parallèle avec un commerçant. « Il ne veut pas fâcher ses clients car celui qui est en face fait ce qu’il veut. L’électeur c’est pareil », appuie-t-il. L’ancien ministre pointe aussi un système où « à droite comme à gauche, des copains de promotion se retrouvent dans l’administration ». « Pour celui qui n’est pas dans cette caste, c’est difficile », regrette-t-il.
Ce qui aboutit à des politiques où « je paye, j’augmente les impôts et je crée des services supplémentaires ». « Ça marche quand tout va bien. Après le risque est de tomber dans le clientélisme. Ce n’est pas forcément comme un chef d’entreprise qui doit s’adapter à un environnement. En politique, on augmente les impôts, on achète la paix sociale à un moment donné d’où le choc de compétitivité », analyse l’ancien Premier adjoint au maire de Marseille.
Daniel Cohen s’interroge quant à lui pour savoir s’il s’agit du « procès des hommes politiques ou de la démocratie » qui est « un dialogue avec le peuple et on ne change pas le peuple ». Contrairement à Jean-Marc Forneri, il ne considère pas que les finances l’Etat soient particulièrement mal gérées. « La France est en déficit structurel de 2%, ce n’est pas la plus mal lotie. Aux Etats-Unis, il est de 6%. Et en période de crise, il existe toujours la tentation de différer les risques et on repousse les ajustements d’où les risques de dévissage des marchés financiers », étaye-t-il.
« Le poison, c’est la réélection »
Il revient également sur le recrutement des élites. « Au début du XXe siècle, on recensait autant d’élèves dans les universités que dans les grandes écoles. Au cours du siècle, on a multiplié par 70 le nombre d’étudiants dans les universités et par 2 le nombre d’étudiants en grandes écoles. La France s’est accrochée à un modèle Malthusien : on peut protéger la France de l’évolution du monde à commencer par le recrutement des élites », argumente l’économiste. Et de s’interroger : « La France va-t-elle s’ouvrir sur le recrutement des élites ? Car elle souffre de ça, de voir qu’il y a aussi peu de rationalité, d’où le divorce avec les hommes politiques », estime-t-il.
Jean-Marc Forneri plaide lui pour « un erasmus des politiques ». « Il faudrait qu’on les fasse tourner en Europe dans des systèmes comparables. Ce serait une mesure de salut public », appuie-t-il.
Alors que « gauche et droite mènent des politiques perçues comme semblables », Xavier Bertrand se demande « qui va proposer des solutions innovantes ? » dans la mesure où « le système n’aime pas les solutions nouvelles » d’où à ses yeux « le risque d’évoluer en deuxième division ». L’ancien ministre estime également qu’« il faut que les hommes politiques gèrent le budget comme les familles et les chefs d’entreprise ». « Plus personne ne fait confiance à personne. On fait peser une charge sur une portion des personnes car tout le monde ne paie pas d’impôt sur le revenu », déplore-t-il.
Une recette qu’il applique pour sa part d’ores et déjà à la mairie de Saint-Quentin. « J’emploie 927 personnes. Chaque fois que j’embauche quelqu’un, je pense 42, 21, 10 : 42 ans de carrière, 21 ans de retraite et 10 ans de pension de réversion de sa veuve. Et c’est la mairie qui paiera tout », souligne-t-il.
Enfin, considérant que « le politique n’est plus là pour décider de tout mais pour créer des écosystèmes favorables aux entreprises », il juge que le problème ne vient pas du cumul des mandats, « qui présentait un intérêt dans un pays centralisé », mais que « le poison, c’est la réélection ». « Il faut du courage politique pour passer outre les manifestations et les oppositions. Or, la question que l’homme politique se demande toujours : “est-ce que je ne vais pas être impopulaire ?”. C’est pourquoi je suis favorable au septennat non renouvelable. Cela amènerait le président de la République à se comporter comme un redresseur d’entreprise et à se libérer de la contingence si française de conserver le pouvoir », conclut Xavier Bertrand.
Serge PAYRAU