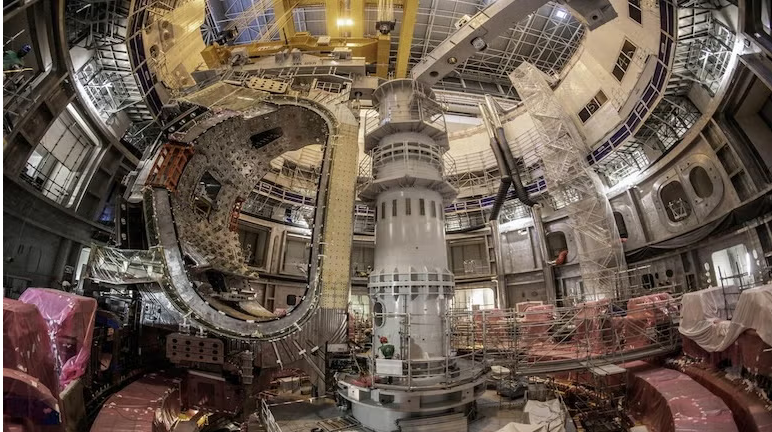Publié le 30 octobre 2017 à 18h36 - Dernière mise à jour le 28 octobre 2022 à 17h42

Destimed: Quel rôle joue vraiment cette énergie noire dont même les films de science-fiction se sont accaparés ? Comment la définir ?
Anne Ealet: L’énergie noire est une traduction de notre non compréhension de l’accélération de l’expansion de l’Univers, découverte récemment. Sous l’effet de la gravité, force qui domine dans l’Univers, on attend que celui-ci, soit s’étende à l’infini, soit se contracte, mais pas qu’il accélère. C’est cette mesure qui interroge sur le contenu de notre Univers et que l’on peut interpréter comme la manifestation récente d’une énergie dont on ne connaît pas la nature et que l’on a baptisé «énergie noire».
Euclid devrait, en langage scientifique, permettre de savoir si l’accélération de l’expansion de l’univers est l’expression d’une déviation de la gravitation; si c’est le cas, comment expliquer cette déviation ?
La gravitation est une force qui est décrite aujourd’hui dans la relativité générale d’Einstein, qui est aussi la théorie utilisée pour décrire l’évolution et l’accélération de l’expansion de l’Univers. Comme la relativité générale est testée uniquement dans le système solaire, il y a des possibilités que sa description de la gravité, au-delà de notre galaxie, soit différente ou incomplète. On se pose donc aussi la question de la validité de la description de la gravité dans la relativité générale d’Einstein.
Qu’est-ce qui a convaincu le physicien Albert Einstein en 1931, lui qui pensait que l’univers était statique, d’accepter la théorie de l’Univers en expansion?
En 1931, l’astronome Edwin Hubble a montré que les galaxies lointaines semblaient s’éloigner de nous, d’autant plus vite qu’elles étaient plus loin. Ce qui était étrange. Une possible explication a été de penser que c’est l’Univers qui s’étend entre les galaxies et non les galaxies qui bougent. Cela revenait à admettre une expansion pour décrire l’évolution de l’Univers. La théorie de la relativité peut prendre cela en compte avec une légère modification des équations qui consistait à enlever un terme qu’Einstein avait introduit et appelé «constante cosmologique», ce qu’il a accepté de faire pour éviter que l’Univers ne s’effondre sur lui-même sous l’effet de sa propre gravitation. Lorsqu’on a découvert que l’Univers était en expansion, Einstein a admis qu’il avait fait une erreur en introduisant cette constante cosmologique (désignée par la lettre grecque Lambda) dans ses équations. Ironie de l’histoire, pour expliquer la découverte récente de l’accélération de l’expansion de l’Univers, une possibilité serait de remettre cette constante cosmologique dans les équations, ce qui reviendrait à revenir aux équations initiales d’Einstein mais pour des raisons différentes.
Cette mission Spatiale vers des “Objets, étoiles ou galaxies inconnues” fait rêver. Quelles autres découvertes sont attendues des astrophysiciens?
Avec plusieurs centaines de millions d’images précises de galaxies et d’étoiles encore jamais mesurées dans l’univers, Euclid apportera une mine de données pour toute la communauté astrophysique, bien au-delà de la compréhension de l’accélération de l’expansion de l’Univers. Cela permettra par exemple: d’étudier la répartition de la matière noire -une autre composante étrange de l’Univers non comprise-, d’étudier les populations de galaxies et de comprendre leur évolution, d’étudier en détail les amas de galaxies qui sont de vrais télescopes gravitationnels -car ils amplifient la lumière des astres qui sont situés plus loin et dans la même direction-, d’étudier les étoiles des galaxies proches, de voir les premières galaxies qui ont été créés dans l’Univers et même de voir des exoplanètes froides -une exoplanète est une planète en orbite autour d’une étoile autre que le Soleil-.
Les détecteurs de vol d’Euclid sur lesquels vous travaillez sont achetés et qualifiés par la Nasa, comment intervient-elle dans ce projet?
Ce projet est d’abord un projet porté par l’Agence Spatiale Européenne (ESA) dans lequel la France, par la contribution de l’Agence Française Spatiale, le CNES, joue un rôle majeur. En particulier, le CNES soutient nos laboratoires, le Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (LAM) et le Centre de Physique des Particules de Marseille (CPPM) pour construire un spectrophotomètre NISP, qui observe dans l’infrarouge. Pour cela nous avons besoin de détecteurs infrarouges dont la technologie spatiale n’existe qu’aux États-Unis. La Nasa, l’ESA et le CNES ont donc passé un accord pour que la NASA nous livre ces détecteurs en échange de la participation d’environ 60 scientifiques américains dans la mission. Ces détecteurs sont arrivés au Centre de Physique des Particules de Marseille (CPPM) où nous les caractérisons en détail. Ces composants seront installés sur l’instrument complet qui sera intégré et testé sur les plateformes du LAM. Les équipes de chercheurs au LAM et au CPPM sont d’ores et déjà à pied d’œuvre pour exploiter Euclid avec le NISP et percer les mystères de l’accélération de l’expansion de l’Univers dès son lancement prévu au plus tôt fin 2020 par une fusée Ariane depuis la base de Kourou en Guyane.
La mise au point de certains instruments embarqués à bord d’Euclid est réalisée en coopération avec le LAM. Comment se passe cette collaboration ?
Nous avons une longue habitude de travailler ensemble sur plusieurs projets en cosmologie que cela soit au sol ou dans l’espace et du point de vue technique et scientifique. Nous avons, par notre Université commune AMU (Aix Marseille Université), des moyens de type LabEx (comme le LabEx OCEVU : Laboratoire d’Excellence Origines Constituants et Évolution de l’Univers), qui nous aide à créer et structurer une animation scientifique ainsi qu’à développer des expertises autour de plusieurs projets communs. Cela nous aide dans la compétition internationale et Euclid est l’aboutissement de ce travail scientifique et technique collaboratif.
Propos recueillis par Christine LETELLIER
Le choix de Marseille expliqué par Olivier Le Fèvre
Le LAM est l’un des quelques laboratoires en France qualifié de “spatial”, c’est à dire qu’il est habilité à livrer aux agences spatiales des instruments fonctionnels développés et testés dans l’environnement très contraignant de l’espace. Son expertise est mondialement reconnue, avec par exemple les images spectaculaires de la sonde Rosetta provenant de la caméra embarquée sur la sonde et conçue au LAM, à Château Gombert. Le LAM a d’autres atouts : Il dispose de plateformes technologiques uniques en Europe pour tester de l’instrumentation scientifique dans les conditions de vide et de température (jusqu’à -269C) de l’environnement spatial. Il est en outre spécialisé dans l’optique et la mécanique de précision des instruments, avec l’expertise système nécessaire pour une livraison “clé en main”.
La maîtrise d’une chaîne complète
De son côté le CPPM (Centre de Physique des Particules) a par ailleurs développé une expertise unique dans les détecteurs électroniques capturant les images des instruments spatiaux, avec une plateforme technologique unique en France. « C’est un fait : les scientifiques dans nos laboratoires sont reconnus pour leur capacité à obtenir les meilleures performances des instruments d’observation en spectroscopie, et en extraire des résultats de premier plan. Il faut préciser que nos expertises complémentaires nous donnent la capacité de maîtriser la chaîne de performance complète du spectromètre NISP d’Euclid. Cela étant, le CNES soutient tout naturellement le LAM et le CPPM pour concevoir, construire, et tester le NISP. Ce qui représente un concentré de technologies qui fait appel au meilleur du savoir-faire spatial en France. Sont bien sûr impliqués dans ce processus les industriels de l’aérospatial et de l’optique-photonique.
CH.-L.
Une plateforme spatiale au Laboratoire d’Astrophysique de Marseille
Et on a tout ça au-dessus de notre tête ! C’est extraordinaire ! Responsable de ce projet? Olivier Le Fèvre explique comment sont aménagées les salles techniques pour l’assemblage des différents équipements du NISP, des chambres à vide (comme la grande cuve Erios de 50 m3 de capacité) qui sont à la température de l’espace, soit à moins 170 degrés centigrades, et puis cette fameuse plate-forme spatiale qui donne au LAM toute sa pertinence en permettant de tester tous les instruments qui seront embarqués sur des satellites (tests de vibrations, pour simuler le décollage de la fusée, puis tests d’exposition au vide et au froid pour simuler l’ambiance spatiale). Vous l’avez compris, c’est in fine une sorte de « passeport pour partir dans l’espace » que livre le LAM et toute l’équipe d’Olivier Le Fèvre.
CH.L.